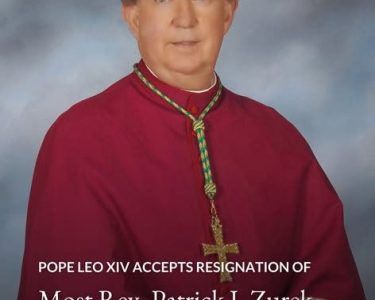En janvier dernier FO disait Non à 85% pour ouvrir les magasins Carrefour le dimanche. Le pape François vient de rappeler, dans sa catéchèse du 13 décembre 2017, l’importance du repos dominical.
L’occasion de revenir sur un débat au problème mal posé.
Lors du débat lancé par Nicolas Sarkozy il y a quelques années, l’aspect confessionnel de la question avait surtout attiré l’attention des commentateurs. Il est vrai que le Jour du Seigneur ne pouvait laisser indifférent les chrétiens. Et ce d’autant moins que, de douloureuse mémoire pour eux, en 1880, la IIIème République avait supprimé l’obligation de choisir le dimanche, trop empreint de l’héritage chrétien, comme jour de repos hebdomadaire, laissant aux patrons la liberté de décider.
Aujourd’hui, le dimanche apparaît comme un acquis social. Et c’est peut-être là son point faible. Les salariés en viennent à s’opposer aux syndicats. Ceux-là même qui sont censés les défendre sont parvenus au point de rupture de l’idéologie de l’acquis social. En poussant à l’extrême la défense de ces « acquis », ils font passer la défense des salariés, donc des personnes, au second plan. Là nous touchons du doigt la dichotomie essentielle entre idéologie et vérité. Tôt ou tard la première se retourne contre la seconde et l’être humain en fait les frais. L’idéologie finit toujours par mettre en place ses propres instances de défense et de survie. Le mythe de l’acquis social en est la parfaite illustration. L’acquis étant par nature ce qui ne bouge plus ne change plus, les syndicats, pour ne parler que d’eux, l’ont peu à peu transformé en principe constitutionnel à la lumière duquel il convient de lire toute action ultérieure. L’acquis devient un dû arraché de haute lutte contre un adversaire toujours soupçonné de vouloir reprendre le combat et menaçant sempiternellement le sacro-saint acquis. L’idée marxiste de la lutte des classes a décidément la vie bien dure. Il s’agirait de prendre sur le dos de l’autre ce dont nous avons besoin. L’équilibre évidemment impossible nous ramène au rapport de forces qui fut un des arguments majeurs du sénateur Jean-Pierre Michel au cours du débat sur la loi Taubira. N’y a-t-il donc pas une autre façon de considérer les relations humaines et particulièrement les relations sociales et économiques ? Si, au lieu de chercher des acquis à défendre contre d’obscurs prédateurs, nous recherchions le bien ? Celui qui profiterait aux uns sans spolier les autres. Ce bien commun qui alors serait justice et non acquis.
Dans la question qui nous occupe, il ne s’agit pas d’abord de savoir si le repos dominical est un acquis, car les salariés qui se battent pour travailler le dimanche considéreront comme un acquis une victoire. Mais il s’agit de placer la dynamique en amont. Face à la demande formulée, qu’est-ce qui est bon ? Bon pour celui qui demande, mais aussi pour la société dans laquelle il vit. En d’autres termes, le travail, comme le repos dominical, induit des problématiques plus profondes que le simple gain financier. Se pose donc la question du travail, du repos, du temps de repos et de travail, du jour choisi, mais aussi de la liberté du travailleur à pouvoir choisir de travailler ou de se reposer et de le faire tel jour plutôt qu’un autre. Se pose également la question du service rendu par ce travail dominical, car le travailleur n’est pas isolé et son choix va impacter le reste de la société. Il faut enfin évoquer, et ce n’est pas la moindre des interrogations, le problème d’un jour de repos commun à tous, autrement dit l’aspect sociabilité du travail et du repos. Le travail a au moins deux vocations irréductibles. Il est intimement lié à la dignité de la personne, tout en étant un service rendu « aux autres ». Or la dignité suppose la liberté. Liberté de choisir de travailler ou non. Mais la liberté appelle la responsabilité, en lien donc avec le service rendu dans ce cas-là. Qui ne travaille pas en assume les conséquences. Mais il est difficile de faire porter à une personne endettée la responsabilité de sa dette si on lui refuse la possibilité de gagner plus. Il faut qu’il y ait un intérêt majeur supérieur pour interdire à l’Homme de gagner sa vie. Mais cet intérêt ne peut en aucun cas se faire au détriment du travailleur. Nous retournerions à la lutte des acquis en nous éloignant de la recherche du bien. Une telle interdiction ne pourrait se faire que si elle correspond à un bien effectif de chaque personne et de la société.
Cela revient à poser la question différemment. En quoi le repos hebdomadaire commun − quel qu’en soit le jour − est-il un bien ? Pourquoi faudrait-il légalement créer un espace commun de repos à tous ? Une fois entendu que le travail nécessite un repos, pourquoi vouloir que ce temps de repos soit commun à toute la société ? Si nous considérons que ce temps de repos partagé est un bien pour tous et pour la société, comment faire en sorte qu’il ne se fasse pas au détriment des travailleurs qui auraient besoin de travailler plus pour gagner plus ?
Le problème se présente encore sous une autre facette. Comment se fait-il que de plus en plus de travailleurs soient obligés de réduire à leur demande leur temps de repos pour pouvoir vivre dignement ? Comment enfin, expliquer la contradiction entre le besoin d’un jour commun de repos (si tel est le cas) et la nécessité de travailler tous les jours ?
La problématique est complexe, mais sa solution est relativement simple. Si nous posons comme postulat que la liberté fait partie de la dignité humaine, le travailleur doit pouvoir choisir librement de travailler ou non, selon un contrat qu’il a librement accepté. Mais la liberté suppose plusieurs préalables. D’une part que le salarié ne soit pas aux abois, prêt à tout accepter pour survivre. D’autre part qu’il puisse exercer sa responsabilité, c’est-à-dire qu’il soit conscient des conséquences que son choix de travailler ou non ont sur lui et sur la société, depuis ses proches, jusqu’à l’ensemble de la population de son pays, voire au-delà. Concrètement cela veut dire qu’il ne doit pas être contraint financièrement de renoncer à son repos nécessaire et qu’il soit convaincu qu’avoir un temps de repos en commun avec le reste de la société est un bien pour lui comme pour elle. Il est alors difficile de se poser en vérité la question du travail du dimanche tant que les conditions de liberté et donc de crise économique ne sont pas résolues. Ici plusieurs niveaux peuvent être considérés. L’urgence tout d’abord. Des situations critiques particulières dans le contexte actuel peuvent-elles justifier de renoncer à ce repos constitutif de la dignité et jugé comme important pour la vie sociale ? Si tel était le cas, une telle situation ne pourrait être que passagère. La rendre structurelle nuirait durablement au travailleur, à sa famille et au-delà donc à la société. En revanche, empêcher quelqu’un de gagner sa vie et le mettre en péril pour préserver son repos et la vie commune serait injuste. La vraie question est de savoir s’il n’y a pas d’autres moyens à lui offrir. Second niveau, la sortie de crise. Si pour un temps limité, il faut mettre les bouchées doubles pour sortir d’une situation délicate, alors par une adhésion libre, il est possible de remettre en cause ce temps de repos, jusqu’à ce que les difficultés se résorbent. Mais il convient pour cela de s’assurer que ce moyen est effectivement efficace pour obtenir un tel but, qu’il sera limité dans le temps et que les conséquences humaines et sociales ne seront pas pire que le mal. En ce sens un effort collectif peut s’avérer nécessaire voire être décrété. C’est ce qui s’est plus ou moins passé avec le lundi de Pentecôte, bien que les fondements anthropologiques n’aient pas vraiment été sollicités, d’où nombre d’incompréhensions et de maladresses. Ce lundi de Pentecôte s’est transformé en un jour choisi dans l’année. Ne pourrait-on pas alors envisager la même souplesse pour le repos hebdomadaire ?
Cela revient à estimer la pertinence d’un repos commun à l’ensemble de la société. En quoi l’Homme aurait-il besoin d’un jour commun aux autres ? Tout d’abord le travail n’épuise pas toute la réalité de la personne qui est fondamentalement un être de relation et un être social, fait pour la vie commune. Comme nous avons besoin d’un lieu pour vivre ensemble, nous avons besoin de temps à partager. Trois dimensions socialisent l’Homme : le temps, l’espace et la durée. Un temps commun est la possibilité de créer un sentiment d’appartenance, de donner à toute une population de respirer ensemble et de pouvoir se retrouver ensemble. L’espace commun permet d’inscrire le temps dans le paysage, de lui donner la possibilité de s’incarner. La ville, le quartier, la maison familiale, le local associatif sont autant de lieux où prendre le temps de vivre ensemble. La durée nous inscrit dans l’Histoire, celle de notre quartier, de notre pays, de notre famille. Aussi disposer d’un temps commun de repos partagé permet au travailleur de réaliser davantage la plénitude de ce qu’il est et de le poser dans une relation gratuite vis-à-vis des autres. Ce jour-là n’est pas fait pour gagner sa vie ni s’épanouir dans son travail, mais pour être gratuitement avec tous que ce soit ses enfants, sa famille, ses amis, les plus pauvres ou son club de sport. La question au fond (avant d’être celle du dimanche) est de savoir si l’Homme a besoin pour son épanouissement de ce temps commun, ce temps social. Parce qu’il introduit le travailleur à plus que ce qu’il est et parce que l’Homme est d’abord une personne humaine avant d’être un travailleur, ce temps social commun à tous est indispensable à la dignité et à la liberté de l’Homme. Mais il est également nécessaire à la cohésion sociale que nous préférons appeler solidarité, c’est-à-dire ce lien intrinsèque qui unit toutes les personnes d’une même communauté et par lequel ce que l’un fait rejaillir sur l’autre. Aussi il importe de préserver et défendre ce temps de sociabilité unique comme un bien commun. Mais le défendre suppose de donner à chacun la possibilité d’être libre et responsable face à sa décision. Si nous voulons favoriser le temps en famille parce que la vie de famille a besoin de ce moment pour son épanouissement, comment concevoir que les parents doivent renoncer à ce temps pour faire vivre dignement leurs enfants ? La dignité sauvée d’un côté est atteinte de l’autre.
La vraie question n’est donc pas celle du travail du dimanche, mais bel et bien comment faire pour que celui-ci ne soit pas un mal nécessaire ? Ne pas poser en ces termes le problème reviendrait à ne pas traiter la réalité des enjeux et passer à côté de ce qui serait véritablement profitable aux personnes comme à la société.