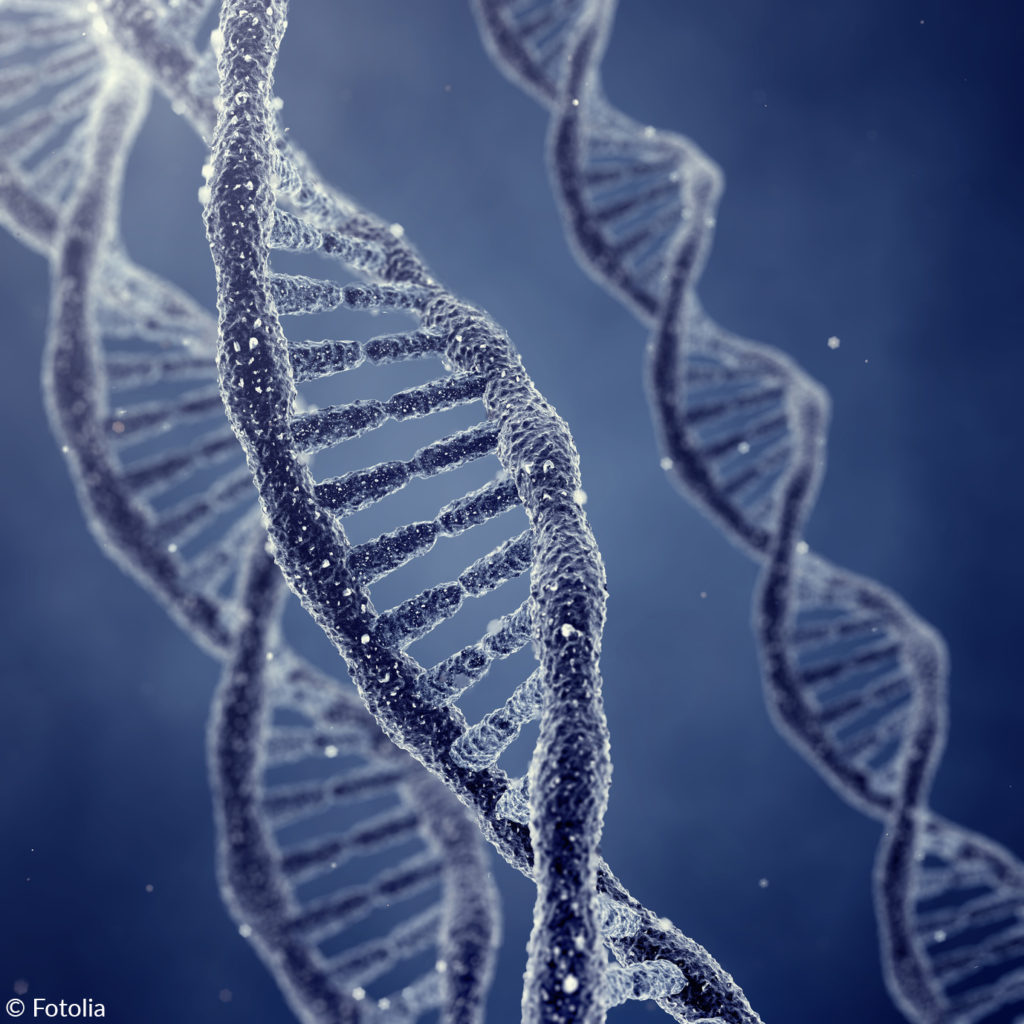Pour sa 5ème journée annuelle, le mercredi 13 juin 2018, le comité d’éthique de l’INSERM s’est penché sur la question de « l’éthique à l’ère de la médecine génomique ». La matinée était consacrée aux interventions de plusieurs chercheurs, notamment celle de Marie Gaille, Directrice de recherche en philosophie au CNRS, et celle de Jean-Louis Mandel, du département de médecine translationnelle et neurogénétique, IGBMC et USIAS. L’après-midi, les travaux du comité d’éthique de l’INSERM ont été présentés notamment par Pierre Jouannet de l’université Paris V. Etaient également présents, pour ouvrir et conclure la journée, Yves Levy, Président Directeur général de l’INSERM, Emmanuel Hirsch, Directeur de l’Espace-éthique de la région Ile de France et Hervé Chneiweiss, président du Comité d’éthique de l’INSERM. Les interventions ont entre autres abordé sur la recherche sur l’embryon et des tests génomiques préconceptionnels.
Et le plus souvent, la volonté de déréguler le cadre normatif et de s’affranchir de certains aspects et enjeux éthiques de taille était manifeste dans les interventions, chez Jean-Louis Mandel, par exemple, ou chez Pierre Jouannet qui est intervenu au sujet de la recherche sur l’embryon. Leurs interventions voulaient conduire une réflexion sur la possibilité d’effectuer des tests génomiques pré-conceptionnels non ciblés (cf. Génomique en préconceptionnel, fin de vie, le Comité citoyen donne son avis dans le cadre des Etats généraux de la bioéthique).
Lors des états-généraux de la bioéthique, l’opinion publique a fait part de ses inquiétudes, concernant notamment les risques liés à l’absence de limites claires posées. Elles ont été évoquées par des chercheurs. Mais leurs prises de position sur le sujet restent profondément marquées par le relativisme ambiant.
Pour Pierre Jouannet, il est nécessaire de passer du principe éthique du moindre mal (cf. La loi Veil, un moindre mal ?), principe énoncé dans un avis du CCNE de 1986[1], au principe de meilleurs compromis. Sur cette base, il n’existe plus d’actes bons ou mauvais. L’essentiel est d’analyser, sur fond utilitariste ou conséquencialiste, si les recherches portent du fruit et non plus de réfléchir si les moyens utilisés pour arriver à ses fins sont bon ou mauvais.
De même, Marie Gaille a cité le philosophe Jonathan Glover, qui établit l’autonomie de la femme comme primat et légitime les tests. Ces tests, et notamment le diagnostic pré-implantatoire, doivent permettre, pour l’auteur qui met en même temps en garde contre une stigmatisation des personnes handicapées, d’éviter « des vies de douleurs ». L’idéal actuel serait la capacité à tout maitriser de sa propre vie.
Alain Fischer, Professeur au Collège de France et médecin à l’hôpital Necker, a d’ailleurs évoqué à juste titre la question du transhumanisme, mentionnant la tentation d’en arriver à des hommes-dieux. Cette philosophie de l’éthique est inquiétante dans la mesure où elle ne laisse la place à aucune limite.
Les intervenants n’en sont cependant pas à une contradiction près. Si Pierre Jouannet affirme que l’embryon n’est pas une personne, il lui reconnait tout de même certaines spécificités. Malgré leurs efforts, une demande de dérégulation législative partielle n’a en réalité aucun sens : soit l’embryon est un être humain et sa destruction à des fins de recherche doit être prohibée, soit il n’est qu’un amas de cellules et la recherche doit être libre. Mais, la réflexion éthique clairvoyante sur le sujet est difficile à assumer pour les chercheurs car elle conduit soit à assumer clairement une contre-vérité, l’embryon n’est qu’un amas de cellules, soit à revenir à une interdiction totale de recherche, ce qui n’est évidemment pas l’objectif visé par la profession.
Sur les manipulations humaines au « profit » de la science, la volonté exprimée d’aller à terme vers la recherche sur des chimères, actuellement interdite par l’article L2151-2 du Code de la santé publique, est un exemple supplémentaire d’une science sans conscience.
Parallèlement, les discussions ont beaucoup porté sur la volonté de limiter le recours aux animaux en matière de recherche. L’importance des débats consacrés à ces derniers semble disproportionnée quand la protection de l’homme est abordée de manière si légère. François Moutou, de l’ANSES[2], a rappelé les orientations actuelles en matière de bien-être animal qui consistent essentiellement en l’exploration de modèles alternatifs aux recherches et aux expérimentations qui les utilisent (cf. Débat autour du « droit des animaux » : ne nous trompons pas de coupables !, Procès des abattoirs : « En voulant traiter les animaux comme les hommes ne va-t-on pas traiter les hommes comme les bêtes » ? et Peut-on calquer le droit de l’animal sur celui de la personne humaine ?). Sabrina Krief, Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, a évoqué les interrogations qui se font jour sur la hiérarchie entre les hommes et les animaux, et entre animaux, ainsi que sur l’idée de droit des animaux. La comparaison entre la manière de traiter la question des recherches sur l’Homme, toujours plus nombreuses, par rapport à celles sur les animaux, à restreindre, a de quoi interroger le bon sens.
Finalement, il est intéressant de remarquer la façon dont la notion d’éthique est dévoyée, utilisée à bon compte et sert à justifier les recherches. Parfois à la manière d’un cache-misère. Paul-Loup Weil-Dubuc, modérateur de la table ronde entre Marie Gaille et Jean-Louis Mandel, a affirmé que l’éthique ne visait pas à s’opposer comme des censeurs. Il ne restait plus, au moment de clore la journée, qu’à « recontextualiser » les valeurs et à analyser ce qui était absolu et ce qui ne l’était pas.
Emmanuel Hirsch et Hervé Chneiweiss ont tout de même rappelé les inquiétudes de la société face aux risques d’évolutions sans limites dans laquelle s’engage la science. Mais à aucun moment, il n’a été question de définir l’éthique. Il semble que passer par cette case soit devenu une simple formalité pour se donner un minimum de bonne conscience requis pour continuer ses recherches.
[1] « Sur un plan éthique, la destruction, parce qu’elle est volontaire comme l’a été la fécondation, ne peut être justifiée par l’argument puisé dans l’observation que, dans la nature, nombre d’embryons dépérissent avant l’implantation. Le Comité considère que cette destruction ne peut être envisagée que dans la perspective de la recherche du moindre mal et qu’elle est inévitable lorsque la conservation n’est pas possible. Cette destruction heurte tous ceux pour qui la vie de l’embryon doit être protégée dès la fécondation », Avis n°8, p. 6, 1986.
[2] Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.